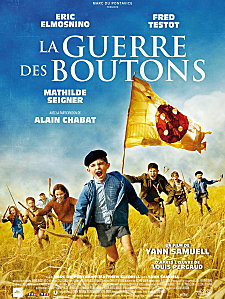Depuis le mois dernier, la Suède donne un label aux films qui sortent pour indiquer leur degré de sexisme (ou non). Il est basé sur le test de Bechdel, créé en 1985 par Alison Bechdel, une dessinatrice féministe américaine, qui évalue la présence des femmes dans un film à base de 3 questions :
– Y a-t-il au moins 2 personnages féminins portant des noms ?
– Ces deux femmes se parlent-elles ?
– Leur conversation porte-t-elle sur un sujet autre qu’un personnage masculin ?
Si les réponses sont oui, alors le film se verra attribuer d’un « label A ».
Si la démarche est honorable, je ne suis pas convaincue que ce test soit le plus à même de juger du sexisme d’un film – soit parce que même si les réponses sont oui, ça n’empêche pas de véhiculer des clichés grotesques ou une vision patriarcale de la société, soit parce que si la réponse est non, ce film peut quand même contrer ces clichés et cette vision.
Preuve en est, par exemple, que Star Wars échoue au test alors que la Princesse Leia est pour moi l’exemple parfait du rôle féminin réussi – mais il n’y en a pas vraiment d’autre dans la trilogie historique (épisodes IV-V-VI) et la réponses aux 2 premières questions est non.
Alors que dans Love Actually (que j’aime beaucoup beaucoup) qui passe le test avec succès (enfin je crois…), les rôles féminins sont cantonnés à femme de, secrétaire de, femme de ménage de, etc. Ce qui, personnellement, m’agace parce qu’on reste dans la femme-définie-uniquement-par-rapport-à-un-homme.
Mais bien avant que je ne prenne conscience de tout ça et que j’analyse tout ce que je vois, j’ai toujours été frustrée, enfant et adolescente, mais sans forcément mettre de mot dessus, de me sentir un peu exclue des films que je voyais.
Particulièrement attirée par la science-fiction, je n’ai jamais vraiment pu m’identifier à des rôles féminins forts (à quelques exceptions près sur lesquelles je vais revenir) comme les petits garçons le faisaient pour à peu près tous ce qu’ils voyaient. Moi, j’en étais réduite à « vouloir » épouser les personnages… C’est un peu triste (et réducteur, donc).

La Princesse Leia, rare personnage féminin fort de la science-fiction
Mais j’ai grandi. Et à l’heure où la Suède instaure donc son label avec lequel je ne suis pas tout à fait d’accord, je me suis dit qu’une petite analyse des personnages féminins dans les films de science-fiction serait sans doute instructive…
Voici donc ma grille de lecture tout à fait personnelle (avec un choix de films tout à fait subjectif) : j’ai classé en 5 catégories les différents statuts des rôles féminins rencontrés dans la SF de ces dernières années.
(Attention, il se peut qu’il y ait parfois des spoilers pour ceux qui n’auraient pas vu les films mentionnés.)
[Ce n’est ni une étude sociologique, ni un jugement de qualité des films, ni un article journalistique, ni un pamphlet pour éliminer les êtres masculins ou assimilés de la surface de la planète, juste un billet personnel sur un blog personnel, merci de vous en souvenir avant de faire des commentaires hors-sujet.]
LES FEMMES QUI NE SERVENT À RIEN

Partie du visuel du DVD français
Irène, interprétée par Uma Thurman, est… Irène, une collègue du héros Jérôme Morrow (Ethan Hawke), astronaute de son état. On ne sait pas quel est son métier, son statut, sa mission. On ne connaît pas son nom de famille. On se demande à quoi sert son personnage à part d’être la caution sexy du film (ce qui n’est pas un vrai rôle, hein)… jusqu’à ce qu’elle ait enfin une utilité dans le scénario.
Et je vous le donne en mille : elle sert d’alibi au héros lors d’un contrôle de salive, qui le refuse en disant au policier « vous ne voudriez quand même pas que le résultat soit faussé, si vous voyez ce que je veux dire… » avec un gros clin d’oeil. No comment.
À la fin, elle deviendra sa petite amie, sans que son personnage n’ait rien apporté de plus à l’intrigue.
Par contre, pour une raison qui m’échappe – enfin non, ça confirme que c’est donc bien la caution sexy du film – elle est très présente sur toutes les versions de l’affiche du film.
Dans Planète Rouge, Carrie-Ann Moss interprète un rôle que l’on pense fort et qui en fait ne sert à rien. C’est elle la chef de la mission martienne, mais… elle a droit au tiercé gagnant : conflit avec l’équipage qui a bien du mal à obéir aux ordres d’une femme ; scène graveleuse où l’un des hommes la regarde en train de se changer ; et finalement, bisou à la fin au seul rescapé de la mission – dont elle devient alors la petite-amie.

- C’est bien, parce qu’elle n’est pas du tout hyper-sexualisée, en plus.
Sans compter que finalement dans le film, son rôle s’arrête bien vite puisqu’après un problème technique, elle ne peut pas descendre sur Mars et reste en orbite. (On l’oublie jusqu’à la fin où elle récupère donc le héros pour lui faire un bisou.)
Perséphone dans Matrix, interprétée par Monica Bellucci, c’est une « femme de », et son rôle se résume à se faire embrasser par le héros. Super intéressant, dis donc. (Je parlerai de Trinity plus tard.)
Dans Matrix, Planète Rouge et Bienvenue à Gattaca, les femmes ne sont donc là que pour faire des bisous au héros et devenir leur petite amie. Jolie transition pour la prochaine catégorie…
LES MÈRES DE / ÉPOUSES DE / FILLES DE
Alors là prenez des RTT parce qu’on en a pour un moment. Je vais essayer de la faire courte et par ordre alphabétique de film.
Dans 2012 (que j’aime beaucoup beaucoup, comme quoi, hein), nous avons l’ex-femme du gentil héros américain, l’épouse bimbo du méchant russe, et la fille du Président qui deviendra par la suite la petite-amie du scientifique de l’histoire (passer du papa au mari, vous imaginez comme j’adore l’idée).
 Double combo également dans Armageddon, où Grace (Liv Tyler) est à la fois la fille de Bruce Willis et la fiancée de Ben Affleck. Elle a quand même un métier, mais dans la boîte de papa (et c’est anecdotique dans l’histoire).
Double combo également dans Armageddon, où Grace (Liv Tyler) est à la fois la fille de Bruce Willis et la fiancée de Ben Affleck. Elle a quand même un métier, mais dans la boîte de papa (et c’est anecdotique dans l’histoire).
À la fin du film, Bruce Willis sauve le monde en se sacrifiant à la place de Ben Affleck juste pour que sa fifille ne soit pas trop perdue. Ben oui la pauvre chérie, si aucun homme n’est là pour veiller sur elle, que va-t-elle devenir, hein ?
Il y a quand même une femme pilote de navette dans la deuxième équipe qui part sur l’astéroïde. Mais c’est un rôle mineur (mais c’est déjà ça).
Pareil pour le personnage d’Amanda Seyfried dans Time Out qui est d’abord la fille de son papa milliardaire avant de se faire kidnapper (devenant une victime) puis de devenir la petite-amie du héros.
Double combo encore pour Avatar (décidément, la femme qui passe du papa au mari, on a du mal à s’en débarrasser, hein), le personnage principal féminin s’appelle Neytiri et elle est la fille du chef du village. Plus tard, elle deviendra la petite-amie du héros. Heureusement, d’autres personnages féminins viennent sauver l’affaire : celui de Sigourney Weaver qui est le médecin responsable de la mission et celui de Michelle Rodriguez qui joue une pilote d’hélicoptère (mais qui, si ma mémoire est bonne, se prend quelques réflexions sexistes au passage, c’est vrai que c’est vachement utile dans le scénario de ce genre de film.)

Sigourney Weaver, femme médecin
Dans Mission to Mars, il y a une femme astronaute dans l’équipage. Hourra !! En fait non. C’est la femme d’un autre astronaute. Ça n’est sûrement pas venu à l’esprit des scénaristes qu’une astronaute pouvait juste être astronaute, et pas en plus la femme de. Parce que si elle avait été « juste » astronaute, ça n’aurait strictement rien changé à l’histoire. Alors ? Une explication ?
Dans Inception, Marion Cotillard est la femme de Leonardo DiCaprio. Heureusement, l’autre rôle féminin du film est plus costaud, j’en parlerai plus tard.
Independence Day, c’est un peu comme 2012 : la petite-amie bimbo du héros, l’ex-femme du scientifique, la femme du Président… Par contre, je ne connais pas le genre des aliens. Quelqu’un pourrait-il m’éclairer là-dessus  ?
?
Dans la trilogie Retour vers le futur, Lorraine est la mère de Marty et Jennifer est sa petite-amie. Un effort à noter du côté du troisième volet où Clara est une institutrice férue d’astronomie. Mais elle devient dès son apparition la petite-amie de Doc… Dommage. C’était bien tenté.
Dans Snowpiercer (toujours en salles, foncez le voir), les 2 personnages féminins du côté des révoltés sont une mère d’un petit garçon disparu et la fille d’un des personnages principaux. Les 3 autres femmes du film ont un rôle un peu moins réducteur… mais… J’y viens tout de suite.
(Mais avant de passer à la catégorie suivante, je viens de me rendre compte de quelque chose d’édifiant : pour chaque film traité jusqu’ici, je peux compter les personnages féminins. Essayez de faire la même chose avec les hommes, pour voir…
Comment ? Non, en effet. Ce n’est pas possible.
Voilà.)
LES RÔLES INTÉRESSANTS… OU PRESQUE
 Snowpiercer, donc, avec unE ministre du train mais qui est complètement sous l’influence du grand gourou Wilford – tout comme l’institutrice enceinte jusqu’aux yeux. Quant au cinquième personnage féminin, peu présent, elle est certes munie d’une arme mais il s’agit d’une sorte d’assistante. En fait, son statut n’est pas très bien défini.
Snowpiercer, donc, avec unE ministre du train mais qui est complètement sous l’influence du grand gourou Wilford – tout comme l’institutrice enceinte jusqu’aux yeux. Quant au cinquième personnage féminin, peu présent, elle est certes munie d’une arme mais il s’agit d’une sorte d’assistante. En fait, son statut n’est pas très bien défini.
Dans L’armée des 12 singes, Madeleine Stowe interprète Kathryn Railly, une psychiatre, auteure et conférencière, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Malheureusement, elle bascule au milieu du film de médecin à victime en se faisant enlever par Bruce Willis.
Elle n’en reste pas moins psychiatre, mais… mais à partir de là, elle est sans arrêt renvoyée à sa sexualité : d’abord victime d’une tentative de viol où elle se retrouve à quatre pattes devant un homme qui commence à se déshabiller en la traitant d’un délicieux « salope » ; ensuite, lorsqu’elle raccroche d’un coup de fil, son interlocuteur la gratifie d’un condescendant « une psychiatre en dentelles et talons aiguilles » ; enfin, quand elle se réfugie dans un hôtel avec Bruce Willis, le mec à l’accueil la prend pour une prostituée. Ça aurait pu s’arrêter là, sauf que dans la suite, un proxénète vient l’agresser dans sa chambre en lui reprochant d’être sur son territoire…
Rôle important dans l’intrigue, psychiatre reconnue… mais ça reste une p…, quand même.
Même combat dans Blade Runner. Il y a 2 personnages féminins. L’une, Pris, est un robot destiné au plaisir sexuel (des hommes évidemment) – et accessoirement petite-amie d’un autre personnage. Quant à Rachel, elle est l’assistante d’un des personnages.
Vous allez me dire : oui, mais dans Intelligence Artificielle, Jude Law joue un gigolo ! C’est exact. Mais il n’est pas tout le temps à poil, lui.
Pour l’instant, les femmes ont beau avoir des rôles importants, elles sont soit renvoyées (voire réduites) à leur sexualité, soit en position d’infériorité dans leur vie professionnelle.

Trinity, le personnage qu'on croyait indépendant et en fait non
On retrouve Carrie-Ann Moss et la fameuse Trinity. Quand, au début du film, on découvre que c’est une hackeuse, on se dit chouette ! un personnage féminin intéressant. Et puis en fait non.
Parce que Trinity malgré son statut de hackeuse, c’est une sorte d’assistante de Morpheus. Alors d’accord, elle court, elle se bat, elle fait de la moto… mais si ce personnage est une femme, c’est uniquement parce qu’il y a une prophétie qui dit qu’elle tombera amoureuse de l’Élu. Aaaah, ok… Moi qui croyais qu’elle pouvait être autre chose que la-petite-amie-du-héros…
Et il y a ce grand moment où elle sauve la vie de Neo… en l’embrassant. Tandis que plus tard, quand c’est Neo qui lui sauve la vie à son tour, il lui fait un message cardiaque. Elle, non. Une femme, ça ne fait pas de massage cardiaque, ça ressuscite d’un seul baiser, c’est bien connu.
Dans Matrix, il y a aussi l’Oracle, qui est une femme. Choix révolutionnaire dans le casting ? Mmmh… non. L’oracle est dans la droite lignée de la Pythie hystérique, de la sorcière maléfique et de la voyante complètement barrée. On reste quand même pas mal dans le cliché…
J’aurais sincèrement voulu mettre Ariane du fabuleux Inception dans la catégorie « rôle féminin réussi ». Elle est architecte, brillante, intelligente, dégourdie… Tout pour plaire. Vraiment. Mais… mais un détail dans le scénario la rétrograde, à mon plus grand regret.
À un moment, dans un rêve, un des personnages lui demande de l’embrasser pour essayer de détourner l’attention de gens qui semblent leur vouloir du mal. Elle n’a pas trop le choix, elle s’exécute. Voici la suite :
– Ça a fonctionné ?
– Non.
– …
– Ça valait la peine de tenter le coup, répond l’homme qui lui a volé un baiser d’un air taquin.
Ariane, comprenant qu’elle vient de se faire avoir, sourit du genre « ah ah ah, quelle bonne blague, on m’a forcée à embrasser quelqu’un, c’est tellement drôle d’être victime d’une agression sexuelle ! » (Oui, un baiser obtenu par contrainte est une agression sexuelle.)
Si le scénariste (Christopher Nolan en l’occurrence) avait été une femme, voici ce qu’elle aurait sans doute écrit :
(… bla bla bla…)
– Ça valait la peine de tenter le coup, répond l’homme qui lui a volé un baiser d’un air taquin.
Ariane le gifle, puis lui sourit d’un air taquin à son tour.
– C’est qu’un rêve, au fond !
L’homme sourit du genre « bien joué, je l’ai bien mérité ».

Voilà. Vous allez me dire – bien entendu… – que ce n’est qu’un détail, que ce n’est pas si grave, que c’est rien qu’un baiser, volé certes, mais qu’il ne l’a pas menacée, etc, etc, etc…
Alors… 1) SI, c’est grave, puisqu’il y a contrainte et que c’est donc puni par la loi. Point.
2) Ça l’est d’autant plus à mon sens que cette scène NE SERT À RIEN. Faites le test : imaginez qu’elle ait été coupée au montage, ça ne change strictement rien à l’intrigue (le personnage l’avoue lui-même) ni aux relations qu’il y a entre les personnages (Ariane n’est plus jamais renvoyée à son statut de femme en potentielle position de faiblesse parmi tous ces hommes). Cette scène est juste là parce que le scénariste n’a pas pu s’empêcher (et peut-être pas forcément de manière consciente, un comble pour un film sur les rêves) de rappeler à ce personnage sa condition de femme potentiellement violable.
Ce sont ces petites choses, ce genre de « détails » qui s’instillent dans nos cerveaux et qui font croire aux garçons que c’est amusant et aux filles que c’est normal. Alors que ce n’est ni l’un, ni l’autre, et que cette scène est strictement inutile.
Et ça m’embête beaucoup parce qu’à part ça, le film et ce personnage sont parfaits.
Dans Minority Report, il y a 2 rôles féminins notables : Lisa, la femme de Tom Cruise et mère de leur enfant disparu, et Agatha la precog. Oui, sauf que… sauf qu’Agatha est un personnage volontairement androgyne. Donc je ne suis pas sûre que ce soit un rôle féminin fort…
LES PREMIERS RÔLES QUI S’EXCUSENT D’ÊTRE FÉMININS
… ce qui nous amène à cette catégorie. Avant toute chose, que ce soit bien clair et qu’on ne m’accuse pas de tout et de n’importe quoi : une femme est une femme, quand bien même elle serait plus musclée qu’un Van Damme, avec les cheveux courts ou rasés (comme Agatha), amputée de son utérus ou de ses seins, née homme mais de genre féminin, ou je ne sais pas quoi encore. Ça, c’est pour la vraie vie, le quotidien, le monde dans lequel on vit. Bon.
 Mais au cinéma, c’est différent : chaque détail est un symbole qui a une signification, c’est à dire qu’un personnage ressemble physiquement à tout ce qu’on veut faire passer comme symbolique (et/ou clichés) à travers lui.
Mais au cinéma, c’est différent : chaque détail est un symbole qui a une signification, c’est à dire qu’un personnage ressemble physiquement à tout ce qu’on veut faire passer comme symbolique (et/ou clichés) à travers lui.
Par exemple… Je ne retrouve pas le lien et c’est dommage, mais j’avais lu un article à propos de la préparation du tournage de Ghost. Quand les deux comédiens principaux étaient arrivés le premier jour sur le plateau, le réalisateur avait failli avoir une attaque parce que Demi Moore avait coupé ses cheveux tout court et que Patrick Swayze, en plus, les avait longs (mais ça a pu s’arranger) – ce qui inversait les rôles « sexués ». Vous allez me dire : on s’en fout. Oui, en effet, mais pas au cinéma, donc. Ce sont des détails qui comptent et ça a été une vraie problématique à gérer pour l’équipe du film. Finalement ils les ont gardés tels qu’ils sont et personne n’y a fait attention, parce que les gens ne sont pas débiles et qu’on allait pas confondre ou croire que les rôles étaient inversés.
Tout ça pour dire, donc, que ce qui paraît être un détail ne l’est pas : c’est soigneusement pensé et réfléchi. Un film dure environ 2 heures, il n’y a pas tellement de place pour les fioritures, tous les détails comptent et ont une signification.

Karen Nyberg, ingénieur et astronaute. COMME QUOI. HEIN.
Ce qui m’amène donc à Gravity où la beauté des images est inversement proportionnelle à la subtilité du personnage principal. Sandra Bullock joue Ryan Stone. Eh oui, Ryan, un prénom masculin. On aurait pu passer outre, mais non, c’est appuyé par un échange entre elle et son collègue : « C’est quoi ça Ryan comme prénom pour une femme ? » « Mon père voulait un garçon. » No comment.
Et je ne sais pas vous, mais moi j’ai été frappée quand elle retire son casque pour la première fois : je ne m’attendais pas du tout à ce qu’elle ait les cheveux courts. Ça m’a énervée, je crois, oui.
Comme chaque détail compte au cinéma, surtout dans ce film bourré de symboles, c’est comme si le scénariste s’excusait d’avoir choisi une femme en rôle principal. C’est agaçant. « Bon ok, c’est une femme, mais… elle s’appelle Ryan et elle a les cheveux courts, hein, ne vous inquiétez pas, c’est un peu un homme quand même ! » Ben oui, des fois qu’on ne la prenne pas au sérieux si elle s’était appelée Karen et qu’elle avait eu de longs cheveux blonds, doux et soyeux, hein.
Pourquoi ne pas avoir choisi un homme pour ce rôle, me direz-vous ? La réponse du réalisateur est très claire : il voulait du symbole, que tout soit attiré vers la « Mother Earth », la renaissance, toussa toussa. Donc d’un côté, Ryan Stone est un garçon manqué, mais de l’autre quand même, elle réunit tous les clichés de la maman, du foetus, de la naissance, etc. Parce que si elle se retrouve dans l’espace, c’est parce que Ryan est une « mère de » qui n’a pas fait le deuil de sa fille disparue – rien de plus. Vous avez dit réducteur ?

Vous avez dit symbole ?
Il y aurait encore tant de choses à dire si ce personnage féminin… Je ne le ferai pas ici, mais sachez que tout ce que j’en pense a été écrit dans ce billet. Le fait qu’il ait été écrit par un homme me rassure, oui, ça me permet d’avoir un argument de poids quand on me reproche (évidemment) d’être parano sur ces histoires de vision de la femme dans le cinéma : on peut être un homme et être gêné par tous les clichés archaïques ou grotesques que véhicule ce personnage, eh oui.
 Suivante dans la catégorie des femmes qui s’excusent d’être des femmes parce qu’elles ont le premier rôle : Ripley, dans Alien. On est d’accord : dans une moindre mesure par rapport à Gravity. C’est à peine comparable. Mais…
Suivante dans la catégorie des femmes qui s’excusent d’être des femmes parce qu’elles ont le premier rôle : Ripley, dans Alien. On est d’accord : dans une moindre mesure par rapport à Gravity. C’est à peine comparable. Mais…
Mais Sigourney Weaver a été choisie parce qu’elle est grande (1m82) et qu’elle a un physique qui se rapproche de l’androgynie. Hop ! on gomme tout ce qui peut se rapporter aux symboles d’une « vraie » femme de cinéma (longs cheveux, coquetterie, sexytude, etc…) Imaginez, par exemple, une Reese Witherspoon dans le rôle de Ripley. Alors ? Erreur de casting, ça ne fonctionnerait pas ? Voilà. CQFD.
Sans compter qu’elle devient « mère de » un alien, qu’elle a des sentiments pour « son bébé » et qu’il y en a pour l’appeler « Maman »… On ne s’en débarrasse pas, hein. Une femme est forcément une mère. Dommage, parce que Ripley a effectivement une fille, mais ça ne change absolument rien au rôle qu’elle a : si elle n’avait pas été mère, le personnage aurait été le même.
LES RÔLES FÉMININS RÉUSSIS
Mais oui ! Il y en a !! C’est possible !!! 😀
Quels sont les critères qui me le font dire ? Eh ben il faut que le personnage ne soit pas affublé de tous les clichés ou symboles que j’ai dénoncés jusque-là. Il faut que ce soit une femme qui ne soit pas définie par rapport à un homme, que son personnage ne soit pas une victime, qu’elle ne soit pas renvoyée ou réduite à sa sexualité, qu’elle ne soit pas privée d’attributs physiques dits « de vraie femme de cinéma », qu’elle peut être mère mais sans que ça ne la définisse de A à Z…
Première à jamais gravée dans mon coeur de geek : la princesse Leia de la trilogie Star Wars. Leia est une femme politique, une meneuse, une résistante, un soldat, une femme qui ne s’en laisse pas compter, qui envoie bouler régulièrement ce relou d’Han Solo, qui sauve Luke qui était venu la sauver mais sans plan pour repartir, etc, etc… La princesse Leia ressemble à une femme sans être hyper-sexualisée (même les scènes en bikini sont soft parce que la caméra ne s’y attarde pas inutilement), elle est volontaire, drôle, avec un caractère fort… Elle est parfaite. PARFAITE.

Autre femme de science-fiction parfaite, et c’est d’ailleurs la principale caractéristique de son personnage, c’est Leeloo dans Le cinquième élément. Dotée d’une intelligence supérieure, imbattable au combat, être suprême… C’est elle qui sauve le monde, et ce n’est pas en faisant un bisou à Bruce Willis, mais l’inverse. Comme quoi, hein.
Un peu moins tape à l’oeil mais tout aussi juste : Jenny Lerner dans Deep Impact, interprétée par Tea Leoni. La personne qui a réalisé ce film est une femme, tiens donc, ça peut avoir joué. Jenny est journaliste, déterminée, pugnace, c’est le personnage principal du film à travers lequel on avance dans l’histoire.
Enfin, last but not least, Ellie Arroway (Jodie Foster) dans Contact. Inspirée de Jill Tarter, qui a été la directrice de l’Institut SETI pendant des années, c’est une scientifique qui se bat pour avoir des subventions pour son projet d’écoute de signaux radio venus de l’espace. Et quand elle capte un signal qui s’avère être extraterrestre, elle devient l’experte absolue dans ce domaine et finit même par être une toute nouvelle sorte d’astronaute.

(Et un petit bonus, même si je ne range pas Thor 2 dans la catégorie Science-Fiction, il est intéressant de voir le traitement des personnages féminins dans ce film encore à l’affiche. Natalie Portman y joue une astrophysicienne, elle a une assistante… qui a elle-même un assistant ! Et quand ces deux-là se découvrent des sentiments amoureux l’un pour l’autre, c’est elle qui prend l’initiative de l’embrasser dans une parodie de scène de baiser  cinématographique où un homme embrasse une femme en la tordant vers l’arrière et vers le bas. C’est là qu’on se rend compte que cette chorégraphie est tout à fait ridicule (et qu’en plus, c’est inconfortable et ça doit faire mal.)
cinématographique où un homme embrasse une femme en la tordant vers l’arrière et vers le bas. C’est là qu’on se rend compte que cette chorégraphie est tout à fait ridicule (et qu’en plus, c’est inconfortable et ça doit faire mal.)
Par contre… il est intéressant de constater que pour ceux deux dernières catégories où une femme a le rôle principal ou un rôle fort, aucune des affiches de ces films ne la montrent. Sauf pour Contact, mais Jodie Foster, assise (passive, rêveuse), est accompagnée de Matthew McConaughey, debout (actif, dans l’action) – rappelez-vous, la symbolique… ; et pour Star Wars où tous les héros sont présentés.
Alors… une femme à l’affiche, d’accord – une femme sur l’affiche, c’est pas encore ça.
Et c’est bien joli de râler et de ne pas être d’accord avec le test de Bechdel, mais si on ne propose pas de solution pour améliorer les choses, ça sert à rien. Alors je propose un autre test, celui-ci composé de 5 questions. Et à la quantité prônée par Bechdel, puisqu’il faut encore choisir entre les deux, je préfère la qualité des personnages. Le voici :
1) Y a-t-il au moins un personnage féminin en premier ou second rôle ?
2) Ces femmes sont-elles définies autrement que par rapport à un homme ?
3) Ces femmes sont-elles exemptes de remarques concernant leur sexualité ?
4) Ces femmes sont-elles exemptes de caractéristiques physiques dites « masculines » ?
5) Pour les femmes qui sont mères, leur personnage existerait-il si elles ne l’étaient pas ?
Faites passer ce test à n’importe quel film. Vous verrez qu’on est très loin d’avoir une représentation saine des femmes dans le cinéma.